les autres et moi,
l'autre et moi,
l'autre moi.
Itinéraire d'une ouverture
à soi et vers autrui Aventure relationnelle vers la lucidité...
autobiographie
| Première
visite Année en cours Archives Elles Bibliographie J'en parle ailleurs M'écrire |
10
septembre 2024
Ultima necat
Un
prolongement critique est ici :
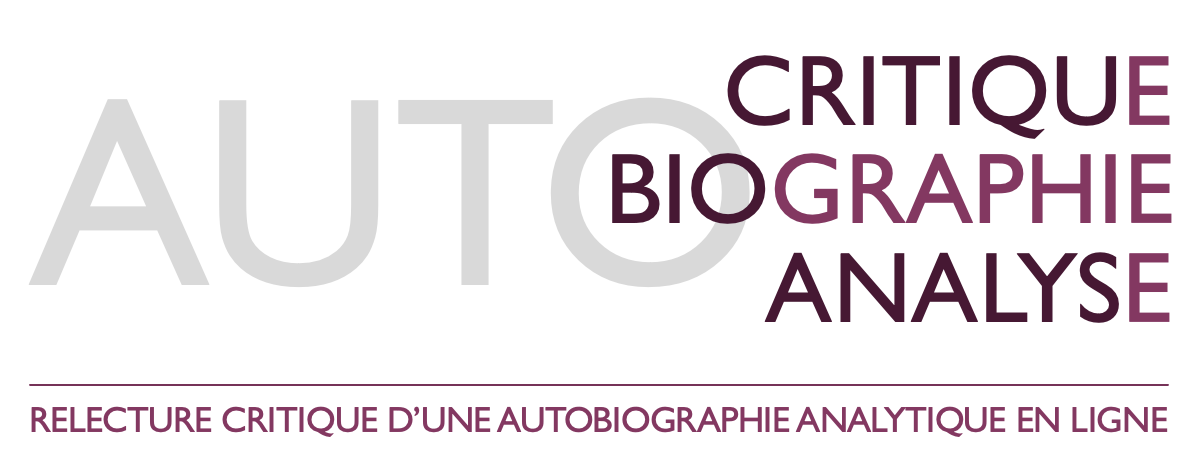
Archives
antérieures
Alter et ego (Carnet)
Le
même en pas
pareil
Liens
Association
pour l'autobiographie
Claviers
intimes [archives]
Avec cette page de clôture je mets un terme
à une enrichissante expérience de journal extime. Ouvert le 22
février 2000, celui-ci s'achève le 10 septembre 2024.
Je n'ai pas l'intention de poursuivre ici
mon expression autobiographique, n'étant pas parvenu à
m'affranchir de certaines limites inhérentes à l'exposition
intime en libre accès. Pour cette raison je n'exclus pas, au
moment où je cesse l'expérience, d'apporter des éléments
complémentaires de bilan ou de regard critique après quelques
mois ou années de recul. Ces éventuels compléments ponctuels
seront distincts du journal achevé et ne pourront concerner
que la démarche : qu'est-ce qu'aura permis une écriture
personnelle ouverte au regard d'autrui ? Quels apports,
quelles limites, quelles conséquences ?
Le Carnet
(blog), créé en parallèle en août 2005, reste potentiellement
actif. Par ailleurs je n'exclus pas de créer un nouvel espace
d'expression, sous quelque forme que ce soit, si j'en venais à
estimer cela bénéfique.
Je remercie chaleureusement les nombreuses
personnes avec qui, par le biais d'échanges impliqués, j'ai pu
explorer toujours plus loin le champ des relations affectives
et de l'expression de soi. Toutefois, avec le temps, ces
échanges ont progressivement cessé et le journal a pris la
forme d'un insatisfaisant monologue, concourant à sa fin.
